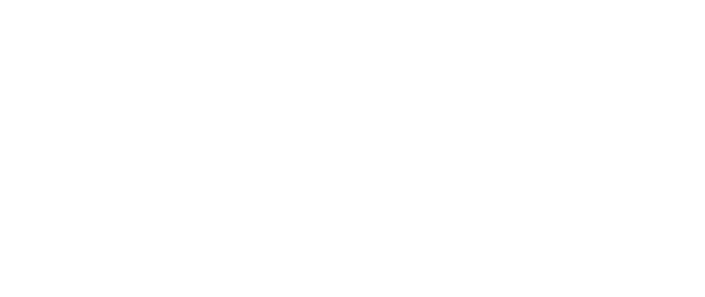La théorie des « quatre tyrannies »
L’objet de l’étude ambitieuse et très fouillée de Scheidler est ce qu’Immanuel Wallerstein a qualifié de système monde, soit des structures de domination et un ordre social qui se sont cristallisés en occident avant de s’imposer sur la planète dans son entièreté. Le néo-libéralisme mondialisé en est l’avatar contemporain. L’auteur distingue deux périodes durant lesquelles ces structures se sont mises en place, du Néolithique au bas moyen-âge d’abord et, à cadence accélérée, des temps modernes à nos jours (soit à peu près les cinq derniers siècles).
Il est difficile de résumer le propos très dense et les thèses, très convaincantes à mes yeux, de ce livre. L’auteur en offre un condensé à travers la théorie des « quatre tyrannies » qui innervent tout le récit : le pouvoir physique (répression, coercition, etc.), la violence structurelle corrélée aux inégalités de statut économique et social, le pouvoir idéologique (essentiellement destiné à justifier les deux leviers de domination précédents) et la plus subtile, qu’il appelle la pensée linéaire. Celle-ci correspond à l’idée qu’une action sera suivie d’effets attendus et mesurables, qu’il est donc loisible aux gens de pouvoir commander à la nature… et aux hommes.
Des structures de domination de l’homme sur l’homme
En onze chapitres captivants et solidement documentés, l’auteur retrace la genèse de cette mégamachine, en identifiant les principaux jalons de cette construction politico-économique (ou plutôt d’ailleurs économico-politique). Cette approche globale des structures civilisationnelles amène à une compréhension renouvelée de l’histoire. Scheidler identifie des phénomènes de différente nature (politique, économique, psychologique) et en explicite la portée à travers le temps et l’espace. En montrant les faux-semblants et les manipulations de l’histoire telle qu’écrite par les dominants, il rend aussi grâce au destin, tragique et négligé, de ceux qui ont été soumis, exploités, massacrés, en vertu des règles de domination susdites.
Scheidler insiste sur les prémisses puis sur les déterminants de la domination de l’homme sur l’homme, de l’instauration des premières cités à l’origine des royautés, aux modernes États militarisés. Il illustre la manière dont l’écriture, la fiscalité, l’utilisation des métaux (armes, monnaie) entre autres, ont permis l’instauration et l’exercice de cette domination. L’idéologie, « qui présente l’expansion de ce système comme une mission providentielle dans l’histoire de l’humanité » joua également un rôle décisif, des mythes anciens à la glorification des prétendues valeurs occidentales, en passant par l’expansion du christianisme et la diffusion du « progrès ».
Logiques de la mégamachine : capitalisme et dévastation
L’auteur insiste sur les débuts de l’ère moderne (XVe au XVIIe siècle) et l’importance d’acteurs comme les cités marchandes, les entreprises de mercenariat ou les premières sociétés par actions. On leur doit l’apparition du capitalisme, entreprise sans limite de génération et d’accumulation de profits. En la matière, loin de s’opposer, marchés et États ont intimement collaboré et lié leur sort.
Il résultera de cette funeste entente une série inédite de dévastations, de catastrophes et de génocides à l’échelle de l’Europe et du globe (conquête des Amériques, guerre de Trente ans, colonisation assortie de pillages et de massacres, pour beaucoup oubliés). L’auteur démontre que ces épisodes tragiques à répétition ne constituent pas des dérapages, sortes d’effets secondaires involontaires d’un processus de civilisation « globalement positif », mais sont inscrits dans la logique même de la mégamachine, lui sont consubstantiels.
Le monde entier est désormais soumis à la course folle de la mégamachine. Si les sociétés occidentales, bouffies de consommation, peuvent s’illusionner sur la prospérité que le système leur apporte, c’est oublier que celle-ci se fonde sur l’exploitation des habitants et des ressources d’une grande partie de la planète. Songeons par exemple aux dégâts causés par les industries extractives, l’agriculture industrielle, etc. Le schéma d’un ou plusieurs centre(s) exploitant les périphéries est pleinement opérant.
Une civilisation en voie d’effondrement ?
Pour Fabian Scheidler, nous vivons à l’ère des crises globales, économiques, environnementales (saccage du vivant, épuisement des sols, des ressources, etc.), sanitaires, etc. Il écrit : « Nous sommes aujourd’hui les témoins de la manière dont toute une planète est consumée par une machinerie économique globale qui engendre simultanément des quantités abyssales de biens et de déchets, des richesses folles et de la misère de masse, des salariés surchargés de travail et des chômeurs qui tournent en rond ».
Or, le système n’a justement pas de fin, car il œuvre à une accumulation infinie de capital (ce qui constitue sa seule fin, au sens de but). Pour autant, il se trouve aujourd’hui confronté à des limites. L’économie mondiale, qui ne profite qu’à un nombre réduit de personnes, est devenue tributaire d’un endettement colossal. La destruction de la biosphère atteint des proportions inquiétantes qui peuvent devenir insoutenables.
Pour Scheidler, l’effondrement de la mégamachine est possible sinon probable. Ce chaos aurait des conséquences difficiles à anticiper mais potentiellement redoutables. Pour s’en prémunir, il est donc urgent de construire une alternative.
« Résister ensemble renforce les liens de solidarité, la confiance en soi et la prise sur le monde »
« Sortir de la mégamachine commence dans nos têtes ». A travers cette formule, Scheidler insiste sur le nécessaire dé-conditionnement, en prenant l’exemple de la mise en concurrence qui nous est inculquée depuis notre plus jeune âge.
Sur un plan collectif, l’auteur n’attend pas de processus révolutionnaire global suivant un « plan directeur ». La sortie du système associerait plutôt, selon lui, « la lente modification des rapports de force à de brusques crises ». S’agissant du premier point, Scheidler met en avant les initiatives et les actions « en dehors de la logique de la machine » et toutes les résistances opposées à cette dernière (contestation de projets écocides, de la marchandisation, etc.). Il en appelle donc à une prise de conscience collective autour de ces mouvements et à une solidarité entre les acteurs. D’où l’importance d’une mise en réseau et de l’élaboration d’un « récit commun » émancipateur. Selon lui, il s’agit d’une condition pour que, lors d’une future crise, la bifurcation se produise dans un sens positif.
Autres préalables nécessaires, sortir de la logique d’accumulation du capital (« couper les vivres aux multinationales » selon les mots de l’auteur), remettre en question la notion de croissance, reposer la question de la propriété, lutter contre la violence structurelle des dettes. Bien des solutions promouvant coopération, partage des ressources et égalité existent, contrairement au mantra néo-libéral (« il n’y a pas d’alternative »).
Concernant la démocratie, Scheidler estime que sa forme représentative, aujourd’hui dévalorisée, ne saurait représenter davantage qu’une étape sur « la voie de l’autodétermination et de l’auto-organisation » qu’il appelle de ses vœux. L’auteur réhabilite aussi les mouvements œuvrant en faveur de la paix et milite pour renoncer à l’idée de dominer la nature.
Parce qu’il donne matière à penser et motif à agir, La fin de la mégamachine est un grand livre que je vous conseille.
La Fin de la mégamachine
Sur les traces d’une civilisation en voie d’effondrement
Fabian Scheidler
Énorme succès à l’étranger, ce livre haletant nous offre enfin la clé de compréhension des désastres climatiques, écologiques, pandémiques et économiques contemporains. Accuser Sapiens, un humain indifférencié et fautif depuis toujours, est une imposture. Notre histoire est sociale : c’est celle des structures de domination nées il y a cinq mille ans, et renforcées depuis cinq siècles de capitalisme, qui ont constitué un engrenage destructeur de la Terre et de l’avenir de l’humanité, une mégamachine.
Mais ces forces peuvent aussi être déjouées et la mégamachine ébranlée. Alors que les alternatives ne manquent pas, quel déclic nous faut-il pour changer de cap et abandonner une voie manifestement suicidaire ? La réponse est dans ce récit. Car seul celui qui connaît sa propre histoire peut être capable de l’infléchir.
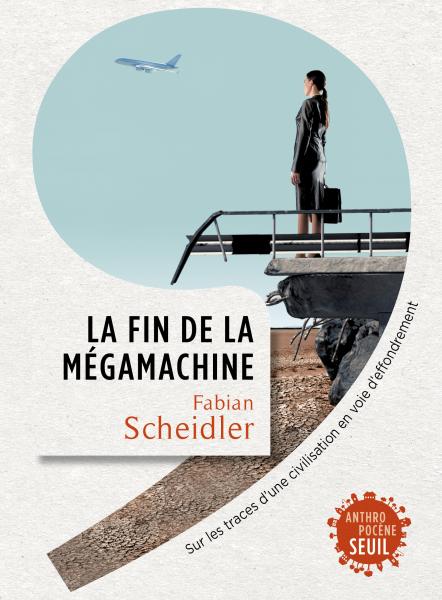
Retrouvez toutes les actualités autour du livre sur le site : https://www.megamachine.fr/
« Aucun sujet n’est plus important. Une contribution d’une grande valeur qui vient à point. »
Noam Chomsky
« Un livre magnifique, d’une actualité brulante. Nous devons à l’auteur gratitude, solidarité et beaucoup d’admiration. »
Jean Ziegler
« Une lecture obligatoire pour toutes celles et tous ceux qui s’élèvent contre un système qui est en train de détruire la vie sur Terre et notre avenir. »
Vandana Shiva
Fabian Scheidler a étudié l’histoire, la philosophie et le théâtre. Il travaille comme auteur indépendant pour la presse, la télévision, le théâtre et l’opéra. Il publie régulièrement dans les Blätter für deutsche und internationale Politik (édité par Saskia Sassen, Jürgen Habermas et al.), la Tageszeitung (Taz) et d’autres revues. En 2009, il obtient le prix Otto Brenner pour le journalisme critique. Il a aussi publié Chaos. La nouvelle ère des révolutions (2017, en allemand).