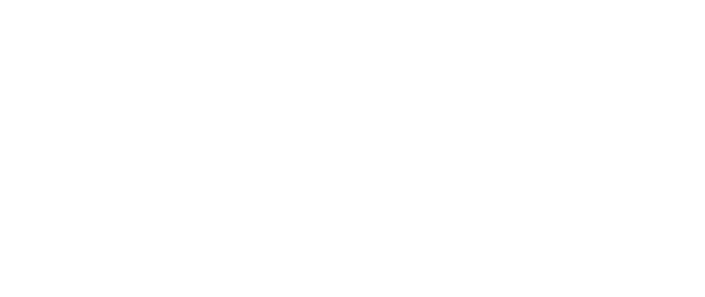Nommer, c’est créer la réalité
Comme Adam nommant les animaux ou la novlangue orwellienne de 1984, celui qui nomme ou renomme les choses exerce un grand pouvoir : définir, c’est structurer la réalité et en déterminer le sens. Quand une autorité attribue une définition aux choses, elle oriente notre rapport au monde et trace les limites du savoir officiel, déclaré licite par les institutions.
De l’immunité à la « stimulation » : une redéfinition lourde de conséquences
Avant la grande affaire du COVID, la définition d’un vaccin, telle qu’enseignée dans les manuels de médecine et reprise alors par l’OMS, était limpide :
« Un vaccin est une préparation contenant des micro-organismes (virus, bactéries) tués ou atténués, ou des parties de ceux-ci, administrée pour induire une immunité contre une maladie. »
Un vaccin était donc une substance administrée dans le but de développer une immunité spécifique et durable contre une maladie infectieuse. Cette définition impliquait une promesse claire : celle de rendre l’organisme immunisé, c’est-à-dire capable de résister à l’infection. La relation de cause (injection du vaccin) à effet (immunité) était claire. Et si un produit échouait, les fabricants pouvaient être tenus pour responsables.
Mais neuf mois après le début des campagnes de vaccination COVID-19, en septembre 2021, alors que l’efficacité réelle des vaccins ARNm contre la transmission était remise en question par une partie de l’opinion et des sachants, et pendant la procédure d’approbation des vaccins pour les enfants, cette définition a subtilement changé. Subrepticement, sans aucune annonce officielle. La nouvelle définition stipule :
« Un vaccin est une préparation utilisée pour stimuler les défenses immunitaires d’un organisme contre une ou plusieurs maladies infectieuses. »
Cette formulation de l’OMS, également reprise par les autorités françaises, insiste sur la notion de « protection » et de « résistance », sans promettre une immunité totale comme la précédente définition. Il est vrai que ces nouveaux produits, développés en urgence, n’offrirent pas toujours une immunité stérilisante (blocage de la transmission) propagèrent le Covid lui-même dans la population et provoquèrent des effets secondaires de morts, maladies graves à vie, stérilité, etc. Dommages collatéraux qualifiés par les autorités d’inévitables.
Ce glissement lexical marque le passage d’une obligation de résultat implicite (le vaccin immunise) à une obligation de moyens (le vaccin réduit les risques). En d’autres termes, le vaccin ne garantit plus que vous ne tomberez pas malade, mais seulement que vous avez statistiquement moins de chances de développer une forme grave. Un changement de paradigme qui, s’il peut sembler réaliste d’un point de vue scientifique, a des implications juridiques majeures.
Une protection juridique renforcée pour les laboratoires
Dans le contexte de la pandémie, les états ont massivement investi dans la recherche et l’achat de vaccins, souvent à travers des contrats confidentiels passés avec les grands laboratoires (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, etc.). Or, ces contrats contiennent des clauses qui ont de quoi faire bondir tout juriste soucieux de l’intérêt public : transfert de responsabilité vers les états, immunité juridique partielle, confidentialité sur les données cliniques, etc.
De plus, les laboratoires peuvent invoquer la clause dite de « risque de développement », qui les exonère de toute responsabilité si le défaut du produit n’était pas décelable au moment de sa mise sur le marché. Une échappatoire juridique taillée sur-mesure pour ces produits développés dans l’urgence, et intégrant des technologies inédites, comme l’ARN messager.
Donc, ce glissement sémantique n’est pas qu’un ajustement scientifique. Il s’inscrit dans une stratégie de gestion du risque juridique. En abandonnant la promesse d’immunité, les laboratoires se prémunissent contre les accusations de défaut de résultat. En parlant de « protection » plutôt que d’« immunité », ils abaissent leur seuil de responsabilité juridique.
En outre, cette nouvelle définition permet également de justifier les campagnes de vaccination de masse, même en l’absence de preuves d’efficacité absolue contre la transmission. Il devient alors plus facile de promouvoir un vaccin qui « réduit les formes graves » sans garantir qu’il empêche la maladie, tout en se protégeant juridiquement contre les conséquences d’éventuels échecs. Scénario que nous avons subi pendant cette plandémie que nous dénonçons. Il n’y a pas de petits profits.
Une industrie pharmaceutique au-dessus des lois
Cette manipulation du vocabulaire médical institutionnel s’inscrit dans le contexte plus large d’une industrie pharmaceutique toujours plus puissante et opaque. Depuis des décennies, les grands laboratoires investissent massivement dans le lobbying, la communication et la sécurisation juridique de leurs produits. La crise du Covid-19 a été l’occasion d’un transfert massif de risques vers les états et les citoyens, pendant que les bénéfices, eux, restaient privés.
Et pendant que les gouvernements répétaient que « le vaccin est sûr et efficace », les entreprises, elles, s’assuraient que leur responsabilité ne serait engagée qu’en dernier recours, voire jamais. Le citoyen, lui, reste seul face aux effets secondaires, aux procédures administratives kafkaïennes, et à une justice qui, bien souvent, ne peut rien pour lui. En Europe, les fabricants de vaccins restent théoriquement soumis à la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Mais dans les faits, prouver qu’un vaccin est défectueux, qu’il a causé un dommage, et que ce dommage est directement lié à l’injection, relève du parcours du combattant. Le fardeau de la preuve repose entièrement sur la victime qui doit démontrer une causalité directe, souvent impossible à établir face à des effets secondaires rares, différés ou mal documentés. Les victimes se retrouvent face à un véritable mur juridique.
En effet, en France, les victimes d’effets indésirables graves peuvent théoriquement se tourner vers l’ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux). Mais ce dispositif, bien qu’indispensable, n’est pas un tribunal : il ne juge pas les responsabilités, il indemnise sur la base d’un lien de causalité médicalement établi. Or, dans de nombreux cas, ce lien est difficile à prouver, faute de données ou de reconnaissance officielle de certains effets secondaires.
Quant aux recours en justice contre les laboratoires eux-mêmes, ils sont rarissimes, longs, coûteux, et souvent voués à l’échec. Les avocats spécialisés le confirment : les chances d’obtenir gain de cause sont minimes, sauf dans des cas très documentés, comme certaines thromboses rares liées au vaccin AstraZeneca. Et même là, les indemnisations sont souvent prises en charge par les états, non par les laboratoires. En résumé, les entreprises empochent des milliards (Pfizer : 100 milliards de dollars en 2022), les états assument les risques et les citoyens n’ont aucun recours contre les fabricants.
Le langage comme outil de pouvoir
Ce glissement sémantique révèle à quel point le langage est un outil de pouvoir. En modifiant la définition du vaccin, les autorités sanitaires ont non seulement adapté leur discours à une réalité scientifique plus incertaine, mais elles ont aussi offert aux laboratoires une protection juridique renforcée, Un passe-droit absolument inédit. Les responsabilités, les attentes, et les recours possibles sont redéfinis dans un cadre plus restrictif qui se retourne contre le peuple. En cas de problème, les citoyens vaccinés se retrouvent de plus en plus seuls. Face à une industrie pharmaceutique surpuissante, à des contrats opaques, à des états complices ou impuissants, et à un droit de la santé publique de plus en plus technocratique, le citoyen n’est plus qu’un usager-cobaye, sans garantie, sans recours, et sans voix. Ce bouclier juridique, construit mot après mot, protège une industrie qui peut œuvrer en toute impunité, quelles que soient les exactions et les crimes que l’on pourrait ensuite lui reprocher. Nous nous trouvons là face à la corruption mondiale de tout un système, bâti sur la complicité criminelle des laboratoires, des états et des institutions internationales.