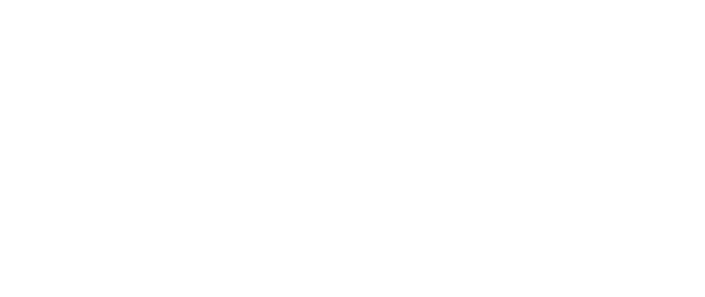Introduction : Milgram et l’étude de la soumission à l’autorité
En 1961, Stanley Milgram, psychologue à l’Université de Yale, lançait une série d’expériences destinées à explorer l’obéissance à l’autorité. Ces séances étaient présentées comme des études sur la mémoire et l’apprentissage, à des volontaires qui tenaient les rôles d’enseignants, d’examinateurs. Ils devaient administrer des décharges électriques croissantes à un « apprenant » (un complice) chaque fois que celui-ci répondait incorrectement à une série d’associations de mots. Les chocs, allant de 15 V à 450 V par paliers de 15 V, étaient simulés, mais les cris et supplications de l’apprenant, diffusés via haut-parleur, semblaient authentiques. Malgré la détresse apparente de la victime, 65% des participants allaient jusqu’à la décharge maximale de 450 V, après quatre relances standardisées de l’expérimentateur en blouse blanche. Ces résultats ont marqué durablement notre compréhension de la psychologie sociale, en montrant la force de l’influence d’une figure perçue comme légitime.
Milgram proposait pour expliquer ces comportements le concept d’« état agentique » : l’individu (l’agent, celui qui agit) perçoit alors l’autorité comme responsable, se déresponsabilise et exécute les ordres « comme un automate ». Or, plus de soixante ans plus tard, des recherches récentes soulignent que cette vision de l’obéissance est trop simpliste et ne rend pas compte de la richesse des réactions observées.
L’autorité à l’épreuve : ce que révèlent les nouvelles expériences de Laurent Bègue-Shankland
Depuis 2018 et avec une publication majeure en 2022, la plateforme SCREEN de la Maison des Sciences de l’Homme Alpes, rattachée à l’Université Grenoble Alpes, accueille une série de recherches dirigées par Laurent Bègue-Shankland consacrées à la soumission à l’autorité. Cette vaste investigation ne se contente pas de répliquer le paradigme originel mis en scène par Stanley Milgram dans les années 1960 ; elle en explore la robustesse et les angles morts à la lumière de nos dilemmes contemporains, notamment ceux qui touchent aux rapports entre humains et animaux.
Les équipes grenobloises ont ainsi réinventé le protocole, le confrontant aux réalités actuelles et questionnant la capacité des individus à obéir à une figure légitime, même lorsque l’injonction concerne la souffrance infligée. Poussant plus loin le curseur, la victime du dispositif peut désormais être humaine ou animale, vivante ou simulée : l’enjeu est de mesurer combien les concepts d’autorité scientifique, d’engagement moral et de valeur accordée à la science, influencent le basculement dans l’acte de torturer sous couvert d’expérimentation.
Cette démarche impose de réinterroger nos représentations : la soumission ne dépend-elle que de la situation expérimentale, ou bien du statut de la victime, de la légitimité perçue du but, ou encore du rapport intime entre conscience morale et promesse scientifique ? Les résultats qui émergent de ce nouveau programme offrent un miroir contemporain à l’expérience de Milgram : l’obéissance n’est ni inévitable, ni monolithique, mais tributaire de pressions complexes et de négociations intérieures, là où se jouent la rationalisation et la résistance individuelle.
La circularité de l’ « état agentique »
La notion d’« état agentique » postule que l’obéissance découle d’une déresponsabilisation volontaire sous l’effet de l’autorité. Mais cette explication est circulaire : l’obéissance prouve la déresponsabilisation, et la déresponsabilisation justifie l’obéissance. Elle n’explique pas non plus pourquoi, dans certaines conditions, l’obéissance chute drastiquement, alors même que la figure d’autorité est toujours présente. Enfin, l’enregistrement des échanges dévoile que les participants négocient, contestent et tentent parfois d’adoucir la souffrance du cobaye, loin de l’image de « robots humains » souvent véhiculée.
La croyance dans la réalité des chocs
Une critique majeure porte sur l’authenticité de l’expérience ressentie par les sujets : auraient-ils simplement joué un rôle, sans croire aux chocs ? Des archives récemment exhumées de Yale montrent que 84% des cobayes pensaient réellement infliger des décharges, et beaucoup ont exprimé un soulagement intense en apprenant la supercherie. Plusieurs d’entre eux ont même consulté les nécrologies locales après l’expérience, craignant d’avoir causé un décès. Ces éléments confortent la validité des réponses émotionnelles et comportementales observées.
Le rôle de la valeur culturelle de la science
L’obéissance ne s’explique pas uniquement par la présence d’un expérimentateur en blouse blanche : elle dépend de la légitimité accordée à l’autorité. Dans l’étude de Grenoble, quand un pair ordinaire donne l’ordre, seulement 20% des sujets vont jusqu’au bout, contre 65% à Yale. De même, transférer l’expérience dans un cadre moins prestigieux (un modeste local commercial) fait chuter le taux d’obéissance à 47,7%. Ces variations montrent que c’est la valeur symbolique de la science elle-même — et non seulement la figure de l’expérimentateur — qui conduit l’individu à se conformer.
Variantes expérimentales et éclairages récents
Soumission à la douleur animale (1972)
Pour tester si la nature de la victime influençait l’obéissance, une équipe de l’université de Berkeley reproduisit le protocole avec un chiot vraisemblablement électrocuté. Aux paliers finaux, l’animal hurlait de douleur, mais 75% des participants menèrent l’expérience jusqu’au bout. Cette variante cruelle confirme que c’est l’autorité — humaine ou scientifique — qui prime, même face à la souffrance animale.
L’effet d’engrenage remis en question (2022)
La théorie d’un « effet d’engrenage » soutenait que l’augmentation graduelle des douleurs infligées faisaient que l’examinateur percevait moins la nécessité éthique d’interrompre le processus. Deux études menées en Pologne ont mis à l’épreuve cette hypothèse : dans un protocole non progressif, les sujets administraient immédiatement 150 V (étude 1) ou 225 V (étude 2) dès la première erreur. Sans montée graduelle, les taux d’obéissance étaient identiques à ceux observés avec la procédure standard, invalidant l’idée d’un effet cumulatif des paliers croissants.
Variations contextuelles de l’autorité
Les 20 variations originales de Milgram révélaient déjà que la proximité de l’expérimentateur, la présence d’un complice encourageant à désobéir ou l’ordre donné par un pair changeaient drastiquement les résultats :
- Si l’expérimentateur était absent et donnait ses consignes par téléphone, le taux d’obéissance tombait à 21%.
- En présence de complices désobéissants, aucun sujet n’allait jusqu’au maximum.
- Au contraire, un lieu de haute légitimité institutionnelle augmentait l’obéissance, comme vu précédemment.
Ces effets contextuels montrent que l’obéissance est un processus dynamique, sensible aux indices de légitimité et aux pressions sociales.
Obéissance raisonnée et stratégies d’évitement
L’analyse qualitative des enregistrements contemporains révèle des comportements de négociation : certains sujets, tout en continuant, tentaient de limiter la douleur en modifiant le rythme de lecture des paliers, en insistant sur la bonne réponse ou en argumentant avec l’autorité pour reporter l’application du choc. Ces stratégies témoignent d’une « obéissance raisonnée », où le sujet intègre à la fois le respect du protocole et ses scrupules moraux.
Conclusion : vers une sociologie de l’obéissance nuancée
Les recherches contemporaines démontrent que la soumission à l’autorité n’est ni uniforme ni inéluctable : elle varie selon la légitimité perçue, la nature de la victime, la structure du protocole et les convictions morales du sujet. Loin de l’image d’une obéissance mécanique, il s’agit d’un compromis actif entre la pression sociale et les valeurs personnelles. Ces éclairages invitent à repenser l’obéissance dans tous les domaines — éducation, science, management ou vie politique — en distinguant l’autorité formelle de son acceptation par ceux à qui elle s’adresse.
Éclairer les mécanismes subtils de cette « obéissance raisonnée » est crucial pour promouvoir un comportement responsable face aux injonctions d’autorité, et pour comprendre comment des individus peuvent résister ou contourner des ordres contraires à leur conscience. Dans notre contexte de post-démocratie à tendance totalitaire, cette connaissance est avidement recherchée par nos maîtres mais elle est également une arme précieuse pour tout résistant.
Sources :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Expérience_de_Milgram
- https://www.msh-alpes.fr/actualites/tuer-science-nouvelle-experience-milgram
- https://www.msh-alpes.fr/actualites/soumission-lautorite-lobeissance-nest-pas-stanley-milgram-croyait
- https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/04/12/quels-facteurs-nous-poussent-a-sacrifier-un-animal_6121865_1650684.html
- https://lamorce.co/a-propos-de-laurent-begue-shankland-face-aux-animaux-2022/