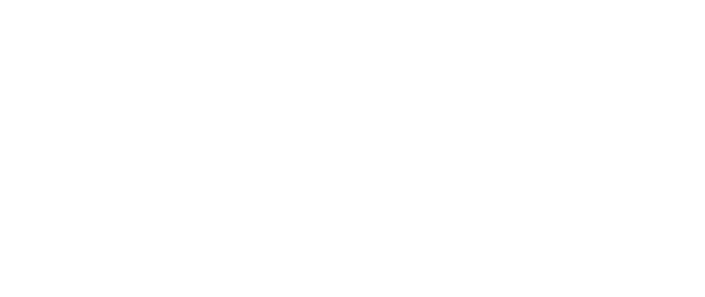De vie à trépas, la baie « des âmes en peine »
La plus belle plage de Plogoff occupe un vaste site enserré entre les deux éperons rocheux majestueux que sont la pointe du Van et la pointe du Raz. Son nom ne laisse pas de surprendre voire d’inquiéter, surtout si l’on est tenté de s’y baigner ou par mauvais temps : la baie des Trépassés !
Si l’origine de ce nom (« bae an anaon » en breton, signifiant littéralement la baie des âmes en peine), reste indéterminée, une tradition celtique rapporte que cette baie était le lieu d’embarquement des druides morts pour l’île de Sein, considérée comme sacrée. Elle reste, aux yeux de certains, empreinte de spiritualité celtique, perçue comme un lieu de passage entre les mondes, entre vie et mort, entre réel et invisible. Des visiteurs disent ressentir une atmosphère singulière, mélange de paix et de mystère, et des bains purificateurs ou des rites druidiques anciens continueraient de s’y pratiquer.
Plus vraisemblablement, l’appellation de la baie pourrait venir du fait que les corps des marins naufragés dans le redoutable raz de Sein s’échouaient sur cette partie de la côte. L’écrivain breton Anatole Le Bras (1859-1926), dans un récit intitulé Impressions de Bretagne, le pays funèbre, daté de 1896, décrit les lieux dans ces termes : « Rien ne saurait rendre l’impression d’infinie solitude, de veuvage, de néant, que donne, l’hiver, cette « bae an anaon », comme l’appellent les Bretons, en leur langue, d’un mot sourd et plaintif, emprunté, dirait-on, au vocabulaire de l’au-delà. La puissante lamentation de la mer, tantôt éclatait en sanglots, tantôt se traînait en longs gémissements… »
Des côtes et des corps
On ne saurait enfin passer sous silence la réputation de pilleurs d’épaves et de cadavres longtemps attachée aux « capistes », les misérables habitants de ce coin de terre reculée que forme le cap Sizun. Pis encore, on les suspectait régulièrement de provoquer des échouages en simulant par des feux allumés sur la côte la présence d’un phare. Le voyageur Dubuisson-Aubenay, en 1636, campe leurs voisins de Sein, mêmement considérés, comme des « gens sauvages qui courent sus aux naufragans, vivant de leurs débris et allumans des feux en leur île pour faire faire naufrage aux passans le Raz ». Si les archives de l’Amirauté de Cornouaille attestent les pillages aux XVIIe et XVIIIe siècles, aucune source n’établit que les capistes soient à l’origine de naufrages. Il n’en reste pas moins qu’ils retiraient une partie de leurs ressources (vivres, vins, toiles, éléments des bateaux etc.) du pillage et de la revente de ces biens prélevés sur la mort… Pour en savoir plus, on pourra consulter l’excellente mise au point suivante :
Loin, très loin de ces faits sinistres, c’est, on se le rappelle, à la baie des Trépassés qu’eut lieu le rassemblement le plus massif et le plus festif des opposants à la centrale nucléaire en 1980. Aux beaux jours, en notre époque de célébration des loisirs et des plaisirs, les corps s’y dénudent, s’y étendent et s’y délassent, profitant de l’air marin, des embruns et du soleil. La vie semble ainsi triompher, en reléguant le monde des morts aux oubliettes. On y met néanmoins en garde les baigneurs contre les risques de noyade, signe que la mort rôde toujours dans la baie des Trépassés…
Déesse mer…
Dans le texte précédent sur Plogoff, nous écrivions au sujet des assauts de l’océan sur la côte : « le granit n’y résiste qu’avec peine, comme en témoignent failles et anfractuosités, et il les endure comme les gens d’ici, les coups durs qui tournent parfois au malheur ».
Et ce pays pauvre et enclavé en connut un certain nombre au cours de son histoire. La mémoire locale reste encore marquée par « an drouc », le mal, une épidémie de peste venue de la mer (de cadavres apportés par celle-ci?) vers 1600. Coincée entre l’océan et des cordons de troupe qui la confinèrent sur quelques kilomètres carrés arides (maudit confinement!), livrée à ses propres moyens, sans secours du dehors, en proie à ce mal inconnu pour lequel il n’y avait aucun remède, la population fut alors presqu’entièrement décimée. Un chant populaire garda la mémoire de cette hécatombe :
« Dégarnie la maison de Cren
Et celle de Guichaoua, de Cléden,
Par crainte du mal
On fit des huttes à la Mare-aux-Moutons.
L’église est pleine jusqu’au seuil
Et le cimetière jusqu’aux murs.
L’église, située sur la pente, était remplie,
Du grand autel, jusqu’au seuil (…)
Cruel eut été le cœur qui n’eût pleuré,
Au pied de la croix de Lescoff, il n’y avait personne
Pour entendre le chagrin et les cris ».
Âmes résistantes !
Plogoff renoua hélas avec les cordons de troupes au cours des années 1970, lorsque le site de Feunteun Aod fut choisi par les autorités pour y construire une centrale nucléaire. Ce nouveau malheur, capable de déclencher une catastrophe pire encore que la peste, déclencha une lutte héroïque, relatée dans un précédent volet, qui permit de le conjurer. L’énergie de la Vie avait triomphé !
L’esprit de résistance qui se manifesta alors à Plogoff et alentour honorait une histoire locale déjà riche. Les rivages de la commune ont en effet vu passer des figures de la résistance à l’occupation allemande. Lors de mon périple côtier, mon attention avait été attirée, sur les hauteurs de Feunteun Aod, par une sorte de menhir, qui s’avéra être une stèle. Celle-ci rappelle sobrement que, le 3 février 1944, échoua dans ces parages le Jouet des Flots du réseau de résistance Dahlia, qui transportait trente-deux résistants et aviateurs dont Pierre Brossolette et Émile Bollaert. Secourus par des résistants du cru, les deux hommes furent hélas capturés peu après. Transférés à Paris, le premier se jeta du cinquième étage du siège de la Gestapo et Bollaert fut déporté à Buchenwald-Dora.
Il est frappant de constater qu’un autre résistant célèbre, Honoré d’Estienne d’Orves, débarqua également sur la côte sud de Plogoff, tout petit village on le rappelle, en provenance d’Angleterre, le 21 décembre 1940. Lui aussi paya cher son engagement puisqu’il fut fusillé par les Allemands au Mont-Valérien le 29 août 1941. Et l’on se rappelle encore que l’île de Sein, à quelques encablures, envoya un bon nombre d’habitants rallier la France libre sitôt la défaite de 1940.
Dans un passé plus lointain, qui nous ramène à la Révolution française, les paroissiens de Plogoff soutinrent les prêtres réfractaires, en cachant certains dans une grotte près de la Pointe du Raz où on leur descendait à manger par un trou secret. Un représentant du Directoire déplorait alors « l’esprit d’incivisme et de révolte » des habitants, qui manifestaient « la résistance la plus ouverte à l’exécution des décrets de la Convention nationale » (21 octobre 1973).
Achevons ainsi notre voyage sur les rudes et belles terres de Plogoff, en rendant hommage à tous les résistants, passants, manants,
contestataires et prolétaires,
pêcheurs, orateurs, rêveurs,
pères, mères, frères et sœurs,
femmes et hommes de coeur,
louves et vieux loups de mer,
craignant, espérant et vivant !